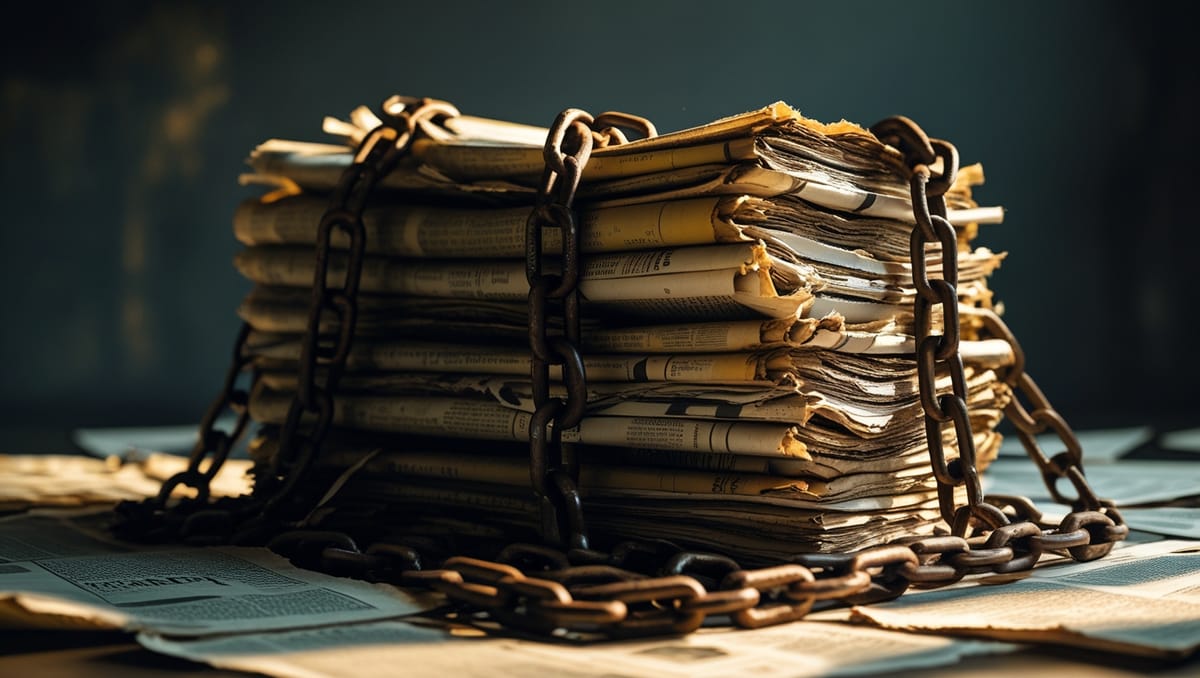Le Burkina Faso a connu deux coups d’États en 2022. Depuis, la situation sécuritaire et humanitaire court à la catastrophe.
En l’espace d’une année, le Burkina Faso a basculé deux fois dans l’instabilité avec des coups d’État successifs. Depuis, la situation sécuritaire et humanitaire ne cesse de s’aggraver et le pays semble glisser lentement, mais sûrement, vers une crise profonde.
Tout commence en janvier 2022. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba renverse le président Roch Marc Christian Kaboré, accusé de ne pas endiguer la menace terroriste qui ronge le pays. Beaucoup de Burkinabés accueillent ce putsch avec un certain soulagement, espérant enfin une réponse forte aux attaques djihadistes. Malheureusement l’espoir ne dure pas. Neuf mois plus tard, le 30 septembre 2022, Damiba est lui-même évincé par le capitaine Ibrahim Traoré. Officiellement, le pays perd du terrain face aux groupes armés – près de 40 % du territoire serait hors de contrôle. En réalité, c’est surtout une lutte de pouvoir en interne.
Un isolement diplomatique qui pèse lourd
Ces bouleversements ne passent pas inaperçus. La Communauté des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) condamne fermement ces coups d’État successifs et impose des sanctions économiques sévères. Pire encore, l’organisation brandit la menace d’une intervention militaire, notamment après la prise de pouvoir des militaires au Niger en juillet 2023.
En septembre 2023, face à cette pression grandissante, le Burkina Faso, le Mali et le Niger serrent les rangs et annoncent la création de l’Alliance des États du Sahel (AES). Objectif ? Afficher une autonomie politique et sécuritaire, tout en s’émancipant des décisions imposées par la CEDEAO. Dans la foulée, le gouvernement de transition burkinabé lance une vaste campagne de recrutement de 50 000 Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). Officiellement, ces civils armés doivent épauler l’armée contre les groupes djihadistes. Officieusement, des témoignages rapportent des pressions voire des enrôlements forcés. Opposants politiques, journalistes critiques : personne n’est épargné.
Approuver le gouvernement ou être engagé de force
S’exprimer librement au Burkina Faso relève désormais du courage voire de l’inconscience. Entre les attaques terroristes et la répression du régime, les journalistes marchent sur un fil tendu au-dessus du vide. La liberté de la presse au Burkina Faso est désormais une utopie.
En juin 2024, trois reporters, Adama Bayala, Serge Atiana Oulon et Kalifara Séré, disparaissent sans laisser de traces. Au même moment, le Conseil supérieur de la communication suspend plusieurs médias, dont 7 Infos et BF1. La consigne est claire : toute voix discordante sera muselée. Le comité pour la protection des journalistes tire la sonnette d’alarme dénonçant un déclin brutal de la liberté de la presse depuis septembre 2022.
Dans ce climat tendu, la propagande bat son plein. Le gouvernement minimise les attaques terroristes, cache le nombre de victimes civiles et impose un récit officiel taillé sur mesure. Même la Russie s’invite dans le jeu avec un soft power bien rodé. En juillet 2024, le jeu vidéo African Dawn, financé par l’organisation pro-russe African Initiative, est lancé.
Son message ? Moscou est le grand sauveur de l’Afrique de l’Ouest. Une manipulation subtile qui vise surtout la jeunesse.
Résultat ? Une population désinformée, piégée entre le silence des médias et la déferlante de propagande. Or, dans un pays où la menace terroriste ne cesse de croître, ne pas avoir accès à une information fiable est une condamnation en soi.
La répression de la presse et la manipulation de l’information aggravent la situation sécuritaire déjà fragile du Burkina Faso. Alors que les civils manquent d’informations fiables, les attaques terroristes se multiplient, exacerbées par une propagande étrangère et l’incapacité des autorités à protéger efficacement la population.
La situation sécuritaire empire depuis deux ans
Le 24 août 2024, une attaque terroriste du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) frappe la ville de Barsalogho. Plusieurs centaines de morts, dont des enfants. C’est l’une des pires attaques de l’année. Le plus glaçant, ce sont les témoignages qui émergent après le drame : plusieurs personnes assassinées ont été forcées par les autorités de travailler dans les zones menacées par les attaques djihadistes.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon Human Rights Watch, entre janvier et août 2024, 6 000 civils ont été assassinés. Dans la même période, l’ACLED recense 259 attaques ayant causé la mort de 1 004 civils. Et il ne s’agit pas seulement de violences terroristes : plus de 1 000 personnes auraient été tuées par l’armée burkinabée et les VDP.
Les exactions sont connues, documentées, mais rarement punies. Prenons l’exemple du massacre de Karma en 2023 : des dizaines de villageois exécutés sommairement. Une enquête a été ouverte... puis enterrée.
Malgré la volonté du gouvernement de vaincre le terrorisme, le nombre de morts liées aux attaques terroristes a plus que doublé entre 2022 et 2023 selon l’ACLED et les groupes terroristes contrôlent la moitié du territoire burkinabé.
Un lourd bilan humanitaire
Entre les attaques terroristes, la répression du régime et la crise humanitaire, l’avenir s’assombrit un peu plus chaque jour.
Derrière les chiffres et les discours officiels, ce sont des millions de vies brisées. En 2024, plus de 2 millions de Burkinabés ont dû fuir leur domicile, la moitié étant des enfants.
L’insécurité alimentaire atteint un seuil critique. Entre les pillages des djihadistes, la sécheresse et la hausse des prix, se nourrir devient un combat quotidien. Dans certaines régions comme la Gnagna et la Tapoa, l’accès à l’eau potable se raréfie, exacerbant encore les tensions.
D’après OCHA, au 31 janvier 2024, 2,3 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire et 6 000 nouveaux cas de malnutrition aiguë sévère ont été recensés.
L’isolement du pays complique encore la situation. La CEDEAO, qui jouait autrefois un rôle d’intermédiaire dans l’acheminement de l’aide humanitaire, n’est plus un recours depuis que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont quitté l’organisation. Human Rights Watch s’inquiète : sans coordination régionale, l’accès aux soins et à l’aide alimentaire devient un casse-tête pour les ONG.
Le Burkina Faso est à la croisée des chemins. L’économie s’effondre, l’insécurité progresse, et l’isolement diplomatique complique toute sortie de crise.
Pour tenter de compenser cette marginalisation, le gouvernement renforce ses liens avec la Russie, notamment sur le plan militaire. Mais ce pari est loin de garantir la stabilité. Pendant ce temps, les civils paient le prix fort. Entre les attaques terroristes, la répression du régime et la crise humanitaire, l’avenir s’assombrit un peu plus chaque jour.